Philippe de Saint-Germain — Dès l’origine, le christianisme s’est pensé comme une religion « dans le monde mais non pas du monde ». Comment ce monde en France a-t-il cessé d’être chrétien ?
François Huguenin. — C’est une longue histoire, à l’évolution complexe, et qui remonte au moins au XVIIe siècle. Ce qui est entièrement nouveau, c’est que la déchristianisation va de pair aujourd’hui avec la perte des valeurs communes. Non seulement la société n’est plus chrétienne, mais la morale — qui n’est pas religieuse en elle-même — n’est plus universelle au sens où elle ne constitue plus un point de rencontre entre chrétiens et non-chrétiens. Pendant des générations, la pratique religieuse a diminué, mais la conscience collective restait de « marque » chrétienne, pour reprendre l’expression de Pierre Manent. De nos jours, les chrétiens pratiquants ne représentent guère plus de 4 à 5% de la population, et la majorité des Français qui persistent à se dire catholiques ne vit plus comme dans une société moralement ou culturellement chrétienne.
En quoi cette situation modifie le rapport que les chrétiens peuvent avoir avec la politique ?
Je pense que cela rend obsolète les postures de domination qui ont longtemps formaté les chrétiens, et plus profondément leur relation au pouvoir. Pourtant, les réflexes demeurent : à droite, la tendance est de confondre christianisme et chrétienté, autrement dit d’attribuer à l’autorité le pouvoir de « faire la norme » ; à gauche, la tentation est de rejoindre le monde en diluant son message au prétexte de rejoindre ses préoccupations. Dans les deux cas, nous restons dans une logique de pouvoir. Or même si le christianisme s’est développé dans le cadre d’une société chrétienne, son existence n’est pas liée à cet état des mœurs ni conditionnée par une forme de pouvoir politique où il tiendrait plus ou moins le manche. Les chrétiens ont d’abord besoin d’une société qui garantisse la liberté religieuse : Vatican II l’a dit clairement, mais les premiers chrétiens le disaient aussi entre le IIe et le IVe siècle !
Au-delà du clivage droite-gauche au sein du monde chrétien, dont vous déplorez à la fois l’existence et l’effet désastreux, ne sommes-nous pas devant des tentations de toujours ? Après tout, les zélotes ont toujours existé qui confondent leur foi avec leurs engagements politiques.
Oui, mais nous avons une autre forme de dérive aujourd’hui qui constitue, même dans l’apparente résistance à l’esprit du temps, une compromission avec l’individualisme contemporain : je veux parler de la tentation du repli, qu’il soit individuel ou communautaire. Nous retrouvons cette tentation aussi bien chez les chrétiens de droite que de gauche. Considérer que son devoir politique consiste à défendre les intérêts ou les « valeurs » de sa communauté n’est ni plus ni moins qu’une réduction du message chrétien qui porte en lui une visée universelle (comme le dit étymologiquement le mot « catholique »). C’est exactement la même chose si l’on refuse de s’engager publiquement en tant que chrétien au prétexte que sa foi relève de la sphère privée. Brandir ses convictions comme celle d’un parti, ou les taire au prétexte qu’il s’agit d’une option purement personnelle, sont deux faces du même écueil : communautarisme et individualisme. Cela relève au fond d’une manière d’absolutiser un intérêt qui, d’une manière ou d’une autre, demeure particulier. Or cette absolutisation, même si elle s’inscrit dans une logique de fonctionnement très contemporaine, c’est ce que la Bible appelle l’idolâtrie (de l’argent, du pouvoir…).
Quel est donc le sens de l’engagement politique chrétien, s’il ne peut être ni communautaire, ni dominateur, ni subjectif ?
Benoît XVI, à qui je rends un hommage particulier dans mon livre, l’a très bien exposé à travers ses nombreuses communications à caractère politique, que ce soit comme théologien ou comme pape, par exemple lors de son discours à Westminster en 2010. La mission politique de l’Église, et des laïcs chrétiens dans leur responsabilité propre, n’est pas d’imposer une norme, mais d’éclairer le débat en aidant le politique à demeurer dans le champ de la raison. Autrement dit, à ne pas céder aux illusions de l’idéologie, de la technique ou aux manipulations en tout genre, comme celle des majorités de circonstance.
Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?
Tout d’abord, accepter les conséquences de la situation présente : la déchristianisation de la société, sa sécularisation, et le caractère minoritaire des catholiques. Les chrétiens sont encore trop dans le déni. Ils doivent faire le deuil de leur position dominante. Le concile Vatican II avait anticipé cette situation, mais la révolution intérieure que cela suppose n’est pas encore complètement assumée. Ensuite, considérer que la priorité est de manifester les principes qui rendent possibles l’exercice d’une politique authentiquement sociale et libre, dans une société individualiste et matérialiste. Dans un monde dominé par le relativisme, on ne peut pas faire l’économie d’un retour à la notion de bien, selon les lois de la grande politique classique. Enfin, pratiquement, cela ne passe pas des grands discours, mais par le témoignage, des actions concrètes de proximité, l’exercice « des pouvoirs » dans la vie de la société civile, plutôt que la recherche « du pouvoir » et de ses mythes.
La relation du monde chrétien avec le monde politique se heurte aux dogmes de la laïcité dont vous rappelez dans votre livre que c’est bien l’Église qui en est l’inventeur. La laïcité tient lieu aujourd’hui de mode de fonctionnement ultime d’une société apaisée, quand ce n’est pas une religion de substitution quoique s’en défende M. Macron. Pourtant, plusieurs visions de la laïcité s’affrontent, sans doute en raison des questions posées par la montée de l’islam, mais dont les chrétiens risquent de faire les frais.
Si la laïcité n’a plus de représentation du bien, elle tourne en rond. Aucune société ne peut vivre sans référence à l’idée même de quelque chose qui lui est extérieur et lui permet de réfléchir sur elle-même. La laïcité a donc besoin, pour ne pas devenir une coquille vide, de chrétiens qui s’engagent en tant que chrétiens. C’est l’essence de notre société qui est en jeu, non pas pour qu’elle redevienne chrétienne (même si un chrétien est tenu à témoigner de sa foi), mais pour exister en tant que société qui continue à s’interroger sur la conception de l’homme et de la vie qu’elle veut promouvoir. Si la démocratie ne s’appuie pas sur un socle éthique, sur une conception du bien qui puisse être largement partagée, elle sera absorbée par les procédures de gouvernance et finira par faire le lit de l’islamisme qui, lui, taille sa route sans états d’âme.
La voix de l’Église sur les questions de société ou sur les questions politiques sensibles n’est pas muette. Pourquoi cette obstination à porter une parole politique si son message est « hors du monde » ?
La grande force politique de l’Église tient au fait qu’elle ne cherche pas le pouvoir, comme le Christ n’a pas voulu établir son royaume sur terre. D’où sa grande liberté pour parler sans complexe à tous les hommes de bonne volonté. Sa parole a vocation à éclairer la décision politique. Que ce message et ses implications pratiques sur les questions qui fâchent comme le respect de la vie, la dignité de la personne au travail ou l’accueil de l’étranger dérange, c’est une évidence, mais c’est d’abord la cohérence d’une vision de l’homme qui répond à des situations très concrètes, aussi bien individuelles que collectives. « Tout est lié » ne cesse d’expliquer le pape François.
N’y-a-t-il pas une grande méprise sur le message social de l’Église, compris à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Église comme un programme politique ?
La mission de l’Église et des chrétiens dans le monde consiste à éclairer les consciences et à servir le bien commun dans la seule perspective de dire et de faire le bien. De fait, le monde médiatique qui est aussi le reflet de la société, interprète ce que dit l’Église sur les questions sociales comme des consignes politiques, comme si l’Église prétendait avoir autorité directe sur les gouvernements. Elle ne le revendique plus depuis longtemps ! Elle rappelle librement des principes universels dont l’application doit garantir à la fois que les États ne versent dans l’arbitraire et le cynisme utilitariste et que les plus faibles soient protégés. C’est à la lumière de ces principes que les États et la société civile dans chaque pays doivent prendre leurs responsabilités, et doser leurs décisions dans leur contexte propre et selon leurs possibilités réelles.
Pourquoi le message donne-t-il l’impression de passer si mal, par exemple hier sur l’avortement et aujourd’hui sur l’accueil des réfugiés ?
Vous avez raison d’associer les deux questions, qui sont emblématiques du message social de l’Église, signe de contradiction avec l’esprit du monde et pourtant d’une profonde cohérence et d’une grande continuité dans l’enseignement des papes. « Tout est lié », encore une fois. Je vous rappelle que la Journée mondiale du migrant a été lancée par le pape Benoît XV. Si aujourd’hui l’appel de l’Église à accueillir les migrants étonne autant, ce n’est pas parce qu’il a changé, c’est parce que le phénomène migratoire prend des proportions nouvelles, à l’échelle de la planète, même si chacun voit le problème uniquement chez lui. Or si l’on prend la peine d’écouter le discours du pape François dans sa globalité, on s’aperçoit qu’il est d’un grand équilibre.
Son message est triple : 1/ les migrants sont des personnes et doivent être traitées avec la dignité qui convient à chaque être humain ; 2/ les États ont la responsabilité de la politique migratoire, selon leurs devoirs et leurs moyens, en s’attaquant d’abord à la cause du mal, l’Église considérant depuis toujours que le premier droit du réfugié est de rester chez lui ; 3/ les migrants contraints de quitter leur pays doivent faire l’effort de s’intégrer dans leur pays d’accueil, de telle sorte que les cultures de chacun et les lois du pays d’accueil soient respectées dans le cadre du bien commun de tous.
C’est-à-dire ?
Le principe est clair : l’accueil du plus faible, en l’espèce le réfugié, mais bien sûr, en fonction de l’état du monde et de la société, marquée chez nous par une grande insécurité sociale et culturelle, nous sommes tenus à faire au mieux et pas à l’impossible ou au suicidaire (par exemple nourrir les conditions d’une guerre civile). De même pour l’avortement, le principe est clair : c’est toujours un mal et un drame. Mais, l’état des mœurs étant ce qu’il est, aucun chrétien sérieux ne revendique l’abrogation de la loi Veil. Mais dans les deux cas, le chrétien aura à cœur de rappeler les principes à temps et à contretemps et d’œuvrer dans la mesure du possible pour des actions concrètes (accueil des migrants dans les paroisses, aide aux femmes pour garder leur enfant).
Que dites-vous à ceux qui reprochent à l’Église et au pape son angélisme ?
C’est un mauvais procès. L’Église est aujourd’hui une des seules organisations à avoir pris la mesure du fait que l’homme est en danger sur des fronts multiples : transhumanisme, inégalités économiques créant une pression migratoire inédite, péril écologique. Que ces questions sont planétaires et que les nations n’ont d’autre choix que s’entendre et coopérer. Ça c’est du réalisme ! En réalité, dans un monde dévoré par l’argent et secoué par les luttes de pouvoir qui procèdent de visions à court terme, l’Église vient rappeler que la maison commune est en péril et que l’homme est menacé. C’est le rôle du chrétien de le rappeler sans cesse et, en donnant à la société un horizon moins étriqué, de lui permettre d’aborder autrement des questions complexes et redoutables sur lesquelles aujourd’hui elle ne cesse de buter faute de vision.
Publié par Causeur sous le titre : « Le discours du pape François sur l’immigration est très équilibré »
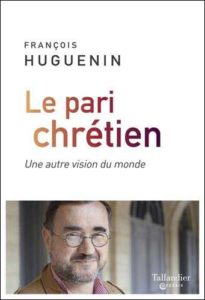 François Huguenin,
François Huguenin,
Le Pari chrétien. Une autre vision du monde
Tallandier, 2018, 220 p., 16,90 €

