 Le bien commun, aujourd’hui ? Un concept fourre-tout qui sert volontiers de slogan aux ambitions politiques les plus honorables, mais aussi les plus fantaisistes. L’opinion le confond avec l’« intérêt général », compris comme la somme des intérêts particuliers. Dans la société moderne, régie par le « contrat » qui régule les tensions entre les rapports de force, le bien commun devient le plus petit dénominateur commun. Or le compromis auquel il donne lieu, fait remarquer Pascal Jacob, « va logiquement se traduire par la satisfaction du plus grand nombre ou tyrannie de la majorité ».
Le bien commun, aujourd’hui ? Un concept fourre-tout qui sert volontiers de slogan aux ambitions politiques les plus honorables, mais aussi les plus fantaisistes. L’opinion le confond avec l’« intérêt général », compris comme la somme des intérêts particuliers. Dans la société moderne, régie par le « contrat » qui régule les tensions entre les rapports de force, le bien commun devient le plus petit dénominateur commun. Or le compromis auquel il donne lieu, fait remarquer Pascal Jacob, « va logiquement se traduire par la satisfaction du plus grand nombre ou tyrannie de la majorité ».
Comment revenir à la juste acception du bien commun ? Dans la société médiévale où le bien est considéré comme une valeur universellement partagée, le bien commun ne s’est jamais distinctement défini. C’est l’objet de la réflexion de Michel Boyancé, doyen de l’Institut de philosophie comparée, qui montre que chez saint Thomas d’Aquin, « le bien commun était une évidence connue d’elle-même ».
Œuvre de la raison pratique, dans une société déterminée, il ne pouvait être apprécié qu’au sein de considérations prudentielles. Si le bien commun est le bien du tout, la difficulté repose sur l’articulation entre le bien du tout et le bien des parties, les personnes, « en tant qu’elles sont en relation dans une société unie ». Mais la personne, être de relation, est aussi sujet de ses actes en vue du bien, autrement dit elle est substance. À ce titre, elle est à elle-même un « tout ». D’où la formule de Paul VI définissant le développement comme « la recherche du bien de l’homme, de tout l’homme et de tous les hommes » (Populorum progressio), formule que l’on pourrait appliquer au bien commun.
Reste la marque propre de l’approche réaliste du bien commun, non systématique comme la pensée moderne pourrait y tendre, avec la nécessaire ouverture au jugement pratique de la prudence pour en apprécier les contours, qui est toujours fonction de la contingence des situations : « Le rapport de la partie au tout relève bien des circonstances, et donc de la prudence. » Cela peut au passage permettre de comprendre pourquoi l’ordre naturel n’est pas un ordre fixiste, inspirant une relation figée entre les principes et l’action, mais un ordre contenant la liberté de celui qui agit vers le bien.
Primauté du spirituel ou primauté du bien commun
Particulièrement intéressant est le travail de Jean-Baptiste Échivard sur la controverse entre Jacques Maritain et Charles De Koninck sur la primauté du spirituel ou du bien commun. Le philosophe lyonnais conclut de manière convaincante, jugeant l’opposition artificielle. Le Québécois voyait dans le personnalisme le risque de la limitation de la personne à sa seule singularité, comme si la jouissance de Dieu ne pouvait se vivre que dans la seule intimité (une dérive nettement combattue par Benoît XVI dans Spe Salvi). Pour autant, la personne n’est pas chez Maritain une monade déracinée, mais un être de culture et de relation, ordonné à Dieu comme bien commun à tous les hommes…
Trois autres études complètent ce dossier, dans l’ordre de l’expérience. « La foi comme bien commun », de Bernard de Castéra, qui développe une thèse classique mais revue dans l’encyclique Laudato si’ : comment penser la foi en tant qu’héritage partagé, et non plus dans l’espace de la subjectivité ?, « Les éléments du bien commun dans une communauté religieuse », par les sœurs du Foyer Marie-Jean, et « Le texte littéraire, espace de participation, ou la littérature comme bien commun », par Emmanuel Échivard.
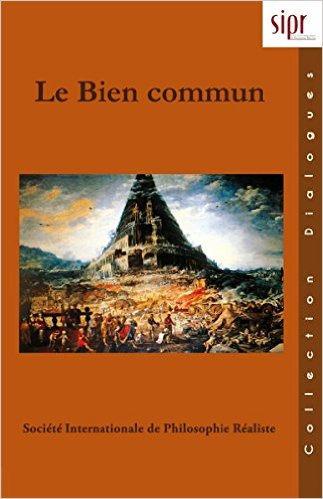 MICHEL NODE-LANGLOIS, MICHEL BOYANCE (DIR.)
MICHEL NODE-LANGLOIS, MICHEL BOYANCE (DIR.)
Le Bien commun
SIPR, coll. « Dialogues », 2016, 126 p., 14 €
